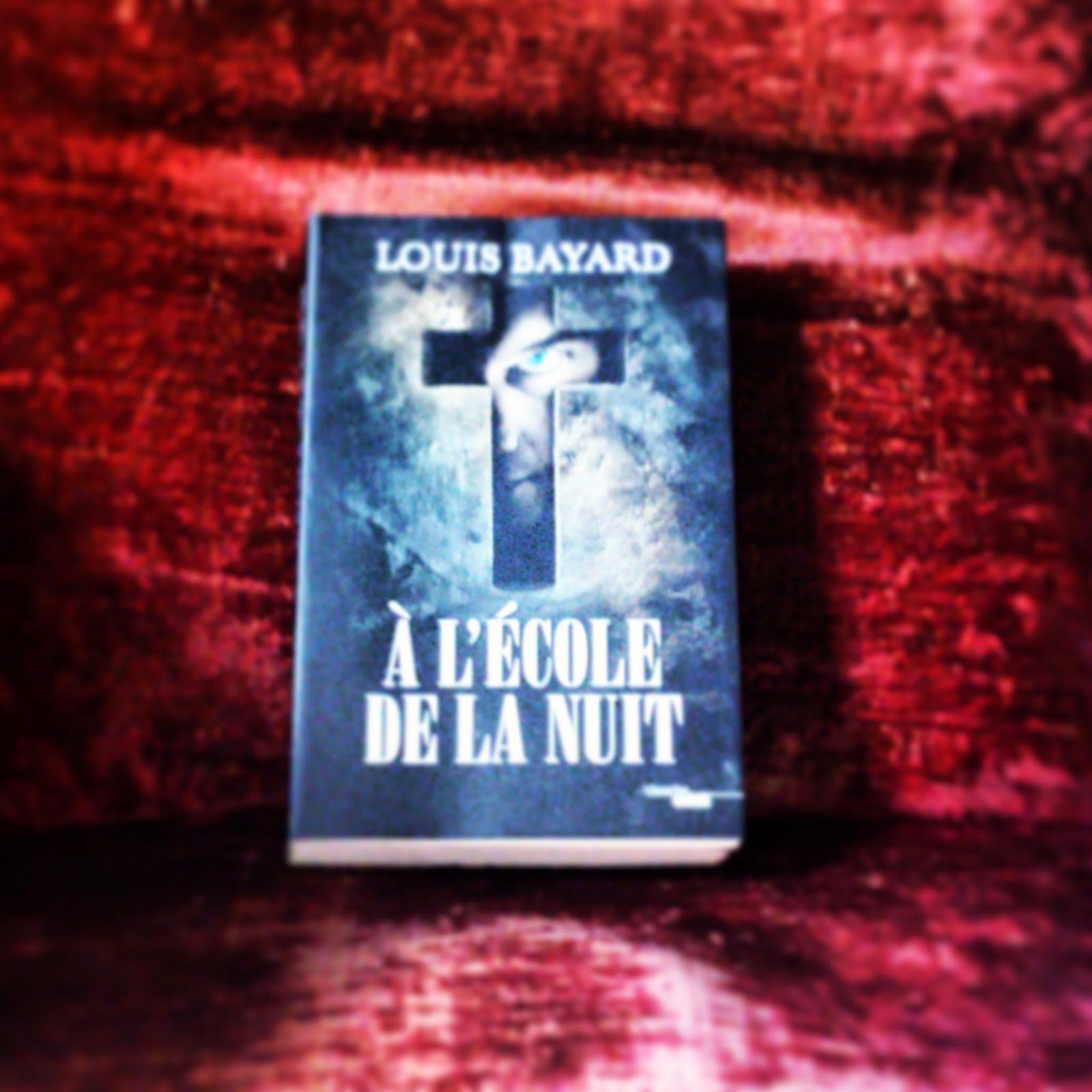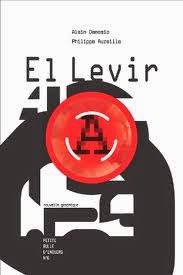Qui est John Dortmunder ?
Pour les petits veinards qui ne connaîtraient pas encore le héros emblématique de Westlake (et à qui il reste donc plein de bouquins à découvrir !), petit portrait du bonhomme :
Dortmunder est un cambrioleur à l’ancienne mode, adepte de la non-violence et des plans bien ficelés, des coups en douce, bref, son casse idéal est celui que la victime sera incapable de voir. C’est aussi (et c’est là que le romanesque intervient) le voleur le plus poissard de toute la littérature. A se demander pourquoi son équipe accepte encore de travailler avec lui. Si Dortmunder se vante de ne pas être superstitieux, il ne peut cependant pas s’empêcher de se convaincre que quelque chose va forcément tourner mal quand tout semble aller pour le mieux. Il faut dire que ses coups les mieux ficelés ont la fâcheuse habitude de virer en eau de boudin.
Son équipe, parlons-en : Stan Murch est le chauffeur de la bande. Un as du vol de bagnoles, fils d’une chauffeuse de taxis, on choisit pas ses parents… Andy Kelp est le meilleur ami de Dortmunder, aussi enthousiaste que son pote est pessimiste, il sert un peu à tout, que ce soit pour baratiner ou pour ouvrir un coffre récalcitrant. « Tiny » Bulcher est le costaud de la bande. Mais vraiment costaud. Tellement qu’on ne le voit presque jamais se battre : faudrait être barge pour attaquer une masse pareille. Judson Blint ou « Le gamin » est un peu la mascotte du groupe, l’aspirant malfrat qui doit encore faire ses preuves (quoi qu’il semble plutôt bien intégré dans Top Réalité).
D’autres membres composent cette joyeuse équipe, en fonction des romans et des besoins du casse. Ces trois-là, avec Dortmunder, forment la bande de Top Réalité.
Top Réalité : l’idée de génie d’un producteur télé
Doug Fairkeep est un cadre dynamique, producteur de reality-shows pour une société baptisée Top Réalité, et de ce fait, son mode de déplacement favori reste la course en taxi new-yorkais, évidemment. Et, évidemment, c’est sur la gentille maman de Stan qu’il va tomber, elle qui trimbale son cab d’un bout à l’autre de la grosse pomme sans jamais oublier de faire la causette au chaland. Quand Doug Fairkeep raconte les coulisses de son métier à la brave Mrs Murch, et lui raconte même le dernier concept d’une émission en cours de développement, la taxi-driveuse réagit au quart de tour : Une émission de télé-réalité filmant des malfrats en train de préparer leur coup, et de le réaliser ? Génial ! Justement, mon fiston est de la partie. Je vous laisse mon numéro… Et voilà donc Stan Murch, puis, par la force des choses, John Dortmunder, et puis Andy, Tiny et le Gamin, embringués dans cette histoire pas comme les autres : la leur. Ou presque, puisqu’il n’y a rien de plus bidonné qu’une émission se proposant de vous dire la vérité… Heureusement, l’équipe de John n’en est pas à un faux-semblant près. Elle semble même bien décidée à se faire un bonus en mordant la main qui se risque à les nourrir.
Inutile d’en dire beaucoup plus. Inutile, non plus, de vous creuser la cervelle à découvrir le grand mystère derrière les mésaventures de Dortmunder et sa bande : pour cette fois, Westlake a passé son tour. On est juste aux prises avec la déveine ordinaire du « cerveau » de la bande, et l’on se marre bien, franchement, à découvrir avec quel génie Dortmunder sait maintenant déjouer les coups du sort. Une capacité d’improvisation hors-pair, Johnny.
Vous avez aimé Ocean’s 11 et Snatch ? Un roman avec Dortmunder, c’est un peu le compromis idéal entre la bande élégante et rusée qui répugne à faire couler le sang, et une équipe d’ouvriers du crime pas toujours bien embouchée. La classe ultime, quoi.
Je ne résiste d’ailleurs pas à l’envie de vous transcrire, en guise de conclusion, quelques lignes du roman, comme ça, hors contexte. Un dialogue entre le fameux Stan et Max, un revendeur de voitures d’occasion, pas très regardant sur la provenance de la marchandise :
« Stan tourna la tête. Le nouveau client qui venait de se joindre aux molécules aléatoires qui arpentaient le parking en long, en large et en travers, était un énorme personnage doté d’une énorme barbe noire et d’une masse de cheveux noirs crépus. Il portait une sorte d’ample chemise hawaïenne, d’un orange terne, de sorte qu’il ressemblait surtout au roi des abricots.
« Eh ben dis donc », fit Stan. Dans son esprit, c’était un compliment.
Penché sur son bureau, émettant un chuintement en direction de la fenêtre, Max demanda : « Tu crois que c’est un journaliste déguisé ?
- En quoi ? En gros tas mou ? demanda Stan en secouant la tête. Allez viens, Max, je vais te montrer la voiture. »
Mais Max continuait de scruter le parking. « Regarde ce qu’il fait. »
Le nouveau venu s’intéressait de près à une Volkswagen Golf, qui n’est pas une voiture particulièrement spacieuse.
« Qu’est-ce qu’il veut en faire ? » demanda Stan.
Le client obèse ouvrait la portière du conducteur. Avant que le neveu de Harriet ait le temps de rappliquer pour aborder le problème, il avait entrepris de s’insinuer derrière le volant.
« Ça va pas le faire. » commenta Max.
L’homme continuait de se tordre et de se contorsionner toujours plus avant à l’intérieur de la voiture.
« Il va partir en la conduisant ou c’est pour s’habiller ?
- S’il peut pas se déshabiller, elle est vendue. On va les laisser trouver une solution sans nous, Stanley, viens me montrer ce que t’as apporté. »
Et ils partirent jeter un coup d’œil à l’ex-Caliber de Stan. »